Les progrès récents des moyens d’exploration ont permis de mieux comprendre le « microbiote intestinal » à qui l’on accorde enfin une juste importance. C’est dans ce contexte qu’une mise en lumière de la présence de bactéries vieilles d’environ 15 millions d’années, présentes dans notre flore intestinale, atteste d’une hérédité génétique qui se trouve renforcée, par cette étude, entre les singes et les hommes.

Un séquençage génétique qui en beaucoup sur la datation incroyable de bactéries intestinales
Dans la revue américaine Science, une étude révèle que notre flore intestinale serait porteuse de bactéries dont l’âge remonterait à environ 15 millions d’années, donc largement avant l’apparition de l’homme ou Homo Sapiens, il y a 200 000 ans, parmi le foisonnement des espèces. Cette découverte renforce la théorie de notre proximité génétique avec les mammifères de l’ordre des primates, aux premiers rangs desquels, les singes. C’est grâce au séquençage génétique que les scientifiques ont isolé et analysé un gène bactérien présent dans les fécaux de trois espèces simiesques (chimpanzés, bonobos, et gorilles) vivant à l’état sauvage dans les forêts africaines coïncidant avec les fécaux d’êtres humains américains.
Nous nous sommes distingués des singes mais nous avons des bactéries intestinales similaires
Cette découverte assoit la quasi-certitude que l’évolution aurait très largement contribué à la composition du « microbiote intestinal » humain. Ce dernier est désormais érigé comme un organe à part entière : l’homme héberge dans son tube digestif quelques 100 000 milliards de micro-organismes vivant en bonne intelligence avec lui. Elle met aussi en exergue une évolution des bactéries en différentes souches, lorsque les ancêtres communs ont commencé à se scinder en des espèces distinctes. Le premier clivage remonterait à 15,6 millions d’années, distinguant les gorilles des hominidés, avant un deuxième, il y a 5,3 millions d’années, marquant la séparation de l’espèce humaine de celle des chimpanzés et des bonobos.










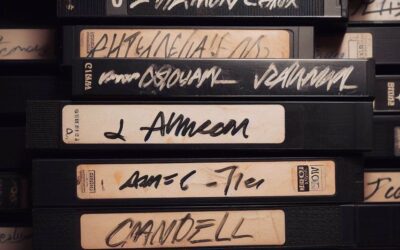

0 commentaires